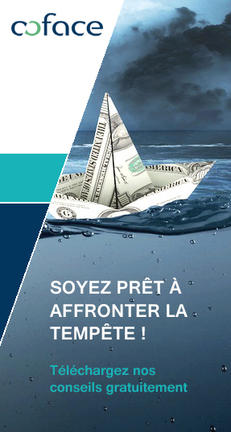Maroc
Synthèse
principaux Indicateurs économiques
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (e) | 2024 (p) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Croissance PIB (%) | -7,2 | 7,9 | 1,2 | 3,0 | 2,9 |
| Inflation (moyenne annuelle, %) | 0,6 | 1,4 | 6,6 | 6,0 | 3,5 |
| Solde public / PIB (%) | -7,1 | -5,0 | -5,5 | -5,5 | -6,0 |
| Solde courant / PIB (%) | -1,2 | -2,3 | -3,5 | -1,5 | -2,5 |
| Dette publique / PIB (%) | 72,3 | 69,5 | 71,5 | 70,0 | 71,0 |
(e) : Estimation (p) : Prévision
POINTS FORTS
- Position stratégique sur le détroit de Gibraltar et proximité avec le marché européen
- Stabilité institutionnelle : attachement à la monarchie et au roi Mohammed VI, société civile active
- Relations soutenues avec l’Europe, les Etats-Unis et les bailleurs internationaux
- Larges investissements entrants depuis l’Europe et sortants vers l’Afrique de l’Ouest
- Stratégie de montée en gamme et de diversification industrielle
POINTS FAIBLES
- Inégalités (pauvreté rurale, chômage des jeunes, manque de logements, corruption…) et tensions structurelles (disparités régionales, opposition islamistes-libéraux)
- Dépendance vis-à-vis de l’agriculture (12% du PIB et un tiers de la population), vulnérabilité aux chocs climatiques et à la variabilité des précipitations (impact des sécheresses sur les récoltes)
- Dépendance commerciale vis-à-vis de l’Union Européenne, notamment dans le tourisme et l’industrie
- Faiblesse de la productivité et de la compétitivité face à la concurrence d’autres pays méditerranéens, comme la Turquie ou l’Egypte
- Contentieux autour de l’ex-Sahara espagnol
Appréciation du risque
Le séisme n’a pas compromis la reprise
A la suite d’une croissance économique terne en 2022, liée aux mauvaises récoltes de céréales, l’activité s’est légèrement accélérée en 2023 grâce à un rebond du tourisme, et ce malgré le tremblement de terre. Le 8 septembre 2023, le versant nord de la chaîne montagneuse du Haut-Atlas a été touché par un séisme de magnitude 6.8, situé à environ 75 km au sud-ouest de Marrakech, principale ville touristique du pays. Le séisme est survenu dans une région peu industrialisée, où les infrastructures sont limitées et qui dépend principalement d’une agriculture de subsistance. L’impact économique a été très limité, notamment parce que le tourisme n’a pas été touché, le secteur a enregistré des résultats records en 2023. Le Maroc a accueilli 14.5 millions de touristes, soit une hausse de 32% comparé à 2022 et de 11,5% par rapport à l’année 2019 pré-Covid. Cette tendance devrait se poursuivre en 2024, ce qui devrait favoriser la croissance puisque le tourisme représente 7% du PIB. Les efforts de reconstruction soutiendront également la croissance, ainsi que l’expansion de la part marocaine du marché mondial de phosphate, le Maroc détenant 70% des réserves mondiales. En juin 2023, le gouvernement a annoncé vouloir multiplier par trois les investissements dans les énergies renouvelables sur la période 2023-2027, comparé à 2009-2022, l’objectif est de développer le réseau électrique national (octroi de licences, production d’hydrogène vert, projets éoliens) et de garantir la ressource en eau (usines de désalinisation). En 2024, le secteur manufacturier continuera de se développer et de soutenir la croissance, via des exportations à plus forte valeur ajoutée, dans l’automobile, l’aéronautique et le textile. Toutefois, les risques sont orientés à la baisse car le pays reste très vulnérable à la sécheresse. La saison agricole 2023-2024 a déjà été fortement affectée par les faibles précipitations et les pénuries d’eau, et la sécheresse pourrait se poursuivre en 2024. La consommation sera soutenue par les flux touristiques, les aides publiques et les envois de fonds des expatriés. Cependant, elle restera freinée par des prix alimentaires toujours très élevés et par les faibles performances agricoles, alors que le secteur emploie un tiers de la population. Alors que le pays s’engagera dans la reconstruction, la Banque centrale (Bank Al-Maghrib) devrait suspendre son resserrement monétaire, appliqué en 2023, et maintenir son taux à 3%, pour faire face à l’inflation, qui continuera de baisser.
La pression budgétaire atténuée par les aides internationales
L’objectif budgétaire de 2023 de ramener le déficit public aux niveaux d’avant covid (environ 3% du PIB), d’ici 2026, est compromis par le séisme. Les réformes fiscales mises en place en 2023 et 2024 permettront d’atténuer ses répercussions, avec notamment l’amélioration du système d’imposition des sociétés, grâce à la suppression progressive de la variabilité du taux normal à 20%, d’ici 2026. En 2024, les subventions alimentaires et énergétiques seront remplacées par des allocations familiales ciblées, pour une meilleure gestion des dépenses publiques. Néanmoins, ces efforts de consolidation fiscale ne suffiront pas à empêcher le déficit budgétaire de se creuser en 2024, par rapport à 2022 et 2023. Le gouvernement a annoncé un plan de reconstruction, budgété à 11.7 milliards d’US dollars, soit 8.5% du PIB, qui s’étalera sur cinq ans. Il sera financé par une hausse des dépenses budgétaires et par une contribution de deux milliards de dirhams (194 millions de dollars) du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Par ailleurs, l’aide internationale réduira la pression budgétaire, sous forme de fonds de solidarité, de prêts et de dons multilatéraux. Le Maroc peut compter sur la ligne de crédit flexible de 5 milliards de dollars accordée par le FMI en avril 2023 pour aider à financer son déficit. A cela, s’ajoute un prêt d’1,3 milliard de dollars, accordé par le Fonds le 28 septembre 2023 pour une durée de 18 mois, afin d’aider le Maroc à faire face aux catastrophes climatiques. En conséquence, le poids de la dette publique augmentera très légèrement en 2024, avec une part extérieure à 42% du PIB.
Le tremblement de terre n’a pas empêché le déficit courant de se réduire en 2023. L’augmentation des importations, liée aux efforts de reconstruction, a été contrebalancée par la hausse des envois de fonds de la Diaspora et par les aides internationales. En 2024, les recettes du tourisme continueront d’accroître l’excédent des services. Néanmoins, l’accroissement du déficit commercial creusera légèrement le déficit courant. Les exportations augmenteront avec la production de phosphate et du secteur automobile, ainsi que l’extension du port de Tanger. Cependant, la hausse des importations sera légèrement plus importante, du fait des projets d’infrastructures, des prix mondiaux des matières premières toujours élevés et de la reconstruction. Ce déficit restera majoritairement financé par des emprunts extérieurs concessionnels et des investissements directs à l’étranger.
La stabilité politique, malgré une frustration populaire liée à la vie chère
Le Premier ministre Aziz Akhannouch, au pouvoir depuis 2021, est à la tête du Rassemblement National des indépendants (RNI), parti majoritaire d’une coalition de centre-droit. La prochaine élection concernera la Chambre des Représentants, chambre basse du parlement, et ne surviendra qu’en septembre 2026. Le pays, stable politiquement, a dû faire face à un mécontentement populaire croissant en 2023 ; conséquence d’un taux de chômage élevé (12%), du coût de la vie renchérie par des épisodes récurrents de sécheresse qui affectent les récoltes. Le séisme a entraîné la mort de 3000 individus et laissé plus de 15000 personnes sans abri. Le plan budgétaire rectificatif dévoilé par l’Etat sera consacré à l’aide d’urgence et à la reconstruction, mais aussi au développement social et économique de la région touchée (70% du montant). L’objectif est d’encourager l’activité économique et de désenclaver les territoires montagneux isolés.
En 2024, les tensions avec le Front Polisario et l’Algérie continueront de se cristalliser autour du Sahara occidental, alors qu’Israël a reconnu la souveraineté marocaine sur ce territoire en juillet 2023, et l’Espagne, le plan d’autonomie marocain en 2022. La première décision s’inscrit dans une volonté de rapprochement, impopulaire, entre les deux pays, ainsi que les Etats-Unis, sur des questions de défense. L’autre s’insère dans le contexte des mouvements migratoires entre les deux rives.
Dernière mise à jour : Avril 2024
Paiement
Le virement bancaire est en train de devenir le moyen de paiement le plus courant pour les transactions nationales et internationales. Le chèque, qui reste un moyen de paiement courant, constitue un titre de reconnaissance de dette efficace, dans la mesure où le débiteur peut être poursuivi en cas de défaut de paiement. La lettre de change est aussi un moyen de paiement intéressant, car elle est une source de financement à court terme par escompte, échelonnement ou virement. Le billet à ordre est utilisé pour garder une trace des détails financiers concernant les dettes personnelles, les dettes d’affaires et les transactions immobilières. Il s’agit d’un contrat juridiquement contraignant, qui peut être utilisé au tribunal si le débiteur n’honore pas sa dette. En cas de litige, un billet à ordre constitue une preuve fiable d’un paiement convenu et donc de l’existence d’une dette.
Recouvrement des créances
Phase amiable
Tout recouvrement de créance doit commencer par une tentative de règlement amiable. La première étape consiste à contacter le débiteur par différents biais (téléphone, avertissements écrits comme des lettres de rappel, les courriers électroniques ou les notifications extrajudiciaires, etc.). Les négociations, qui peuvent être intenses, portent sur des points tels que le nombre de versements, l’éventualité d’une annulation de la dette, les garanties/sûretés, ou le calcul des intérêts pendant la période de grâce. La loi marocaine autorise un avocat à reconnaître la signature du débiteur dans le cadre d’un plan de paiement, lequel doit être signé, certifié et légalisé par les autorités compétentes au Maroc. L’avocat des créanciers peut ensuite utiliser ce plan de paiement comme reconnaissance de dette en cas d’action en justice.
Procédure judiciaire
Le Maroc possède un système juridique qui relèvent de la tradition juridique française, et des tribunaux qui relèvent de la tradition islamique (qui concernent exclusivement le statut personnel des justiciables). Parmi les tribunaux, on trouve des juridictions de proximité, chargées du règlement des litiges entre particuliers, les tribunaux de première instance compétents en matière civile, les tribunaux de commerce, qui traitent des différends commerciaux, les cours d’appel, compétentes en matière civile et administrative, et la Cour de cassation.
Procédure en urgence
Lorsque la dette est liée à un titre ou à une promesse reconnue, il est possible d’obtenir une injonction de payer. Il faut pour cela envoyer une requête au greffe du tribunal compétent. La dette doit être avérée, liquide (c’est-à-dire libre), exigible, et ne faire l’objet d’aucune contestation. Si le défendant ne présente pas de défense dans un délai de huit jours, il est possible d’obtenir une décision exécutoire. S’il présente une défense dans un délai de huit jours après réception de l’injonction de payer, le dossier est renvoyé en procédure ordinaire. Toutefois, la chambre des appels du tribunal de première instance ou la cour d’appel peut, suspendre par arrêt motivé, partiellement ou totalement l’exécution.
Procédure ordinaire
La procédure s’ouvre par l’envoi d’une assignation au débiteur après dépôt d’une requête par les représentants du créancier devant le tribunal compétent. Le débiteur peut alors présenter une défense dans un délai prescrit par le juge et déposer une demande reconventionnelle. Il peut être nécessaire d’organiser plusieurs audiences consacrées au dépôt et à la transmission des documents écrits et des éléments de preuve éventuels.
L’audience principale ordonnée par le juge est l’occasion d’entendre les plaidoiries. Débats et plaidoiries sont diligentés par le juge au cours de l’audience publique. Les juges débattent ensuite sur les moyens, les motifs et la décision. Après délibération, une décision motivée est rendue par le juge. L’ensemble de la procédure dure généralement en moyenne, 14 mois.
Exécution d’une décision de justice
Une décision devient exécutoire dès lors que toutes les possibilités d’appel ont été épuisées. Une ordonnance de saisie permet de saisir et de vendre les biens du débiteur.
La législation marocaine oblige les tribunaux à reconnaître les sentences étrangères, y compris celles qui sont émises dans des pays qui ne sont pas signataires d’un traité d’application réciproque avec le Maroc. Pour obtenir l’application d’une sentence étrangère, il faut déposer auprès du tribunal l’exemplaire original de la sentence, accompagné d’un document certifiant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un appel. Quand un étranger obtient un jugement final qu’il entend faire appliquer au Maroc, c’est une procédure d’exequatur qui s’engage, de même que pour l’application de sentences marocaines à l’étranger. Il existe deux procédures de réalisation : l’une est strictement marocaine ; l’autre est déterminée par la signature d’un accord bilatéral entre le Maroc et d’autres pays, notamment l’Allemagne, la Belgique, les États-Unis, les Émirats arabes unis, l’Espagne, la France, l’Italie et la Libye.
Procédure d’insolvabilité
Les procédures d’insolvabilité sont régies par le livre V du Code du commerce. Elles comportent un volet informel visant à prévenir les difficultés du débiteur (procédure d’alerte et procédure de règlement à l’amiable) et un volet formel (procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire).
Suite à la situation de la COVID-19, le Maroc a pris deux mesures dans le cadre de la procédure d’insolvabilité :
La possibilité pour les sociétés débitrices d’entreprendre la procédure de demande d’un délai de grâce afin de leur permettre de suspendre légalement les paiements. (à condition que l’insolvabilité soit causée par le COVID-19)
La possibilité d’obtenir un crédit relance dédié au entreprises impactées par la COVID-19.
Procédure d’alerte
Cette procédure d’alerte relève de l’initiative des partenaires ou auditeurs de la société (auditeurs externes engagés par l’entreprise pour redresser la situation financière), qui ont le devoir de prévenir le gérant de l’entreprise de toute possibilité de redressement dans un délai de huit jours. Si aucune mesure n’est prise pour régler la situation dans un délai de 15 jours, il convient de convoquer une assemblée générale afin de décider de la façon de redresser la situation en s’appuyant sur le rapport de l’auditeur.
Règlement à l’amiable (La conciliation)
La procédure de règlement amiable est réservée aux sociétés commerciales, aux négociants et aux artisans qui rencontrent des difficultés financières sans toutefois être insolvables. Lorsqu’elle est engagée, le débiteur est placé sous la supervision du tribunal qui désigne pour une période de trois mois un conciliateur externe chargé de l’aider à parvenir à un accord avec tous ses créanciers ou avec ses « principaux créanciers ». Ces derniers ont droit à la totalité de leur créance, mais le conciliateur peut proposer un arrangement amiable, ou les créanciers peuvent céder une partie de la dette s’ils le souhaitent. Une fois l’accord éventuel approuvé par le tribunal, toute procédure judiciaire liée aux dettes couvertes par l’accord est suspendue pour la durée de l’accord de règlement à l’amiable.
Procédure de sauvegarde
C'est un mécanisme est destiné à permettre à une entreprise de se réorganiser afin de continuer à vivre. Pour en bénéficier, la société devra établir qu’elle n’est pas en état de cessation de paiements. Mais, dans le cadre de cette procédure, on permet encore de négocier avec vos créanciers, afin d'éviter d'en arriver à cette cessation de paiements, au redressement judiciaire. C'est l’entreprise qui saisit le tribunal, lequel prononce un jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La procédure commence par la période d'observation, d'une durée de six mois (renouvelable une fois) pendant laquelle l'administrateur judiciaire, en collaboration avec le gérant, établit le « bilan économique et social » (BES) de l'entreprise : un point sur l'origine des difficultés, la situation financière actuelle, les mesures de redressement à envisager et les perspectives qui en résultent. Pendant cette période, l’entreprise prend les mesures propres à redresser la situation, et elle aide l'administrateur à élaborer un plan de sauvegarde. L'adoption d'un tel plan par le tribunal marque la fin de la période d'observation et le début du plan proprement dit, dont la durée peut aller jusqu'à cinq ans. Là encore, le gérant reste maître à bord de son entreprise mais, surtout, la société va bénéficier de mesures radicales que le tribunal peut seul imposer :
- suspension des échéances des dettes ;
- arrêt des poursuites individuelles ;
- obligation pour tous les créanciers de déclarer leurs créances ;
- arrêt du cours des intérêts.
redressement judiciaire
Cette procédure n’est disponible qu’aux débiteurs en cessation de paiements dont la situation financière n’est toutefois pas irréversible. Le tribunal désigne un juge commissaire et un mandataire judiciaire (désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation judiciaire, agit également comme syndicat). Au cours de cette procédure, la société débitrice poursuit son activité et reste en la possession de ses dirigeants. La procédure de redressement peut déboucher sur la réorganisation de l’entreprise débitrice ou sur sa liquidation. Le mandataire judiciaire prépare un rapport sur la situation de la société dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ce rapport, il recommande un plan de continuation pour le débiteur, la vente de l’entreprise, ou encore sa liquidation. Le tribunal est alors tenu de rendre une décision sur la base de ce rapport. Dans le cadre de cette procédure, les créanciers n’ont pas la possibilité de donner leur avis sur les options disponibles.
Liquidation judiciaire
La mise en liquidation judiciaire rend toutes les dettes du débiteur dues et exigibles. Les créanciers marocains disposent d’un délai de deux mois pour soumettre leurs réclamations. Ce délai est étendu à quatre mois pour les créanciers qui vivent à l’étranger. Il peut être mis un terme prématuré à la procédure de liquidation avant distribution si le débiteur n’a plus de dette, le mandataire judiciaire dispose de fonds suffisants pour rembourser intégralement tous les créanciers, ou le débiteur ne dispose pas des fonds suffisants pour payer les frais de liquidation judiciaire.
Le droit marocain n’établit pas de règles précises en matière de priorité des réclamations dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Cependant, certains créanciers bénéficient d’un statut privilégié : salariés, trésor public, organismes sociaux, créanciers dans le cas d’une procédure de conciliation collective, et enfin, les créanciers non garantis.