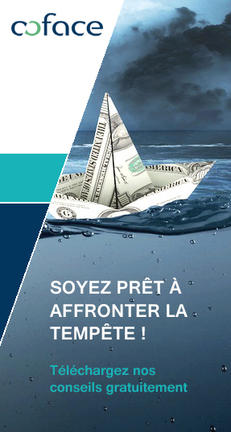Mali
Synthèse
Principaux Indicateurs économiques
| 2020 | 2021 | 2022 (e) | 2023 (p) | 2024 (p) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Croissance PIB (%) | -1.2 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
| Inflation (moyenne annuelle, %) | 0.5 | 3.9 | 9.7 | 4.0 | 2.5 |
| Solde public / PIB (%)*
| -5.4 | -4.9 | -4.8 | -5.0 | -4.5 |
| Solde courant / PIB (%) | -2.2 | -7.7 | -6.9 | -6.5 | -5.5 |
| Dette publique / PIB (%)
| 46.9 | 50.4 | 51.7 | 51.5 | 52.5 |
(e): Estimate (f): Forecast *Including grants **Including official transfers
POINTS FORTS
- Larges ressources naturelles agricoles (coton) et minières (or, bauxite, lithium)
- Importantes remises des expatriés
- Membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
POINTS FAIBLES
- Situation sécuritaire dégradée par la présence de groupes djihadistes sur une grande partie du territoire
- Junte militaire au pouvoir à la suite des coups d’Etat de 2020 et 2021, et reprise des affrontements avec les Touaregs du Nord
- Économie vulnérable aux aléas climatiques et aux fluctuations des cours des matières premières
- Pauvreté répandue
- Enclavement géographique
- Dépendance à l’aide internationale
- Mauvais environnement des affaires (instabilité politique, insécurité)
- Manque de transparence de l’industrie aurifère
Appréciation du risque
La croissance repose sur le coton et l’or
En 2024, la croissance se maintiendra, soutenue par l’agriculture et le secteur minier. Après une campagne 2022-2023 affectée par les attaques d’insectes nuisibles, les inondations et l’embargo de la CEDEAO, les rendements agricoles 2023-2024 devraient s’améliorer, soutenus par les mesures gouvernementales en faveur du coton (subventions aux engrais, hausse du prix d’achat aux producteurs de 10 à 295 FCFA le kg). Les cours élevés de l’or et la production du premier concentré de spodumène de la mine de lithium de Goulamina, détenue par la société australienne Léo Lithium, la chinoise Ganfeng Lithium et le gouvernement malien, permettront d’augmenter la production minière. Néanmoins, les investissements, en dehors du secteur extractif, resteront freinés par l’insécurité et l’instabilité politique. Ce climat fragile limitera également le développement rural et la consommation privée (74% du PIB), pourtant favorisée par la décélération de l’inflation. En effet, depuis 2023, les prix alimentaires se modèrent grâce au redressement de la production agricole et aux cours mondiaux baissiers. Après une hausse de son taux en septembre 2023, pour atteindre 3,25%, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ne devrait plus resserrer sa politique monétaire, en ligne avec la BCE.
Le financement extérieur des déficits bloqué par le coup d’Etat et le régime militaire
Le déficit public diminuera légèrement grâce à la mise en place du nouveau code minier, promulgué en août 2023. Celui-ci permet de gonfler les recettes en augmentant la participation maximale de l’Etat et des investisseurs locaux dans les projets miniers, de 20% à 35%, tout en supprimant des exonérations fiscales accordées aux entreprises au cours de l’exploitation. Mais, l’assainissement budgétaire, fondé aussi sur les réformes administratives et la rationalisation des dépenses, restera limité, puisque la junte doit augmenter ses dépenses militaires et sécuritaires après le retrait des forces occidentales. De plus, les dépenses seront toujours obérées par les rémunérations des fonctionnaires, représentant 55% des revenus fiscaux, et par la poursuite de la Stratégie nationale de stabilisation des régions du Centre et son plan d’action triennal (2022-2024), budgété pour un total de 956 milliards de FCFA. Elle vise le retour à la sécurité et l’amélioration de la gouvernance et de la présence étatique, ainsi que le redressement économique. Le déficit public restera financé par des emprunts domestiques, ainsi que par des levées de fonds sur le marché de capital de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). En effet, les tensions sécuritaires et politiques continueront de bloquer tout financement extrarégional, y compris le renouvèlement de la Facilité élargie de crédit du FMI, expirée en août 2022. La dette publique, notamment domestique (30% du PIB), poursuivra sa trajectoire ascendante et le pays pourrait être confronté à des problèmes de liquidité et de solvabilité, si les émissions continuent d’être sous-souscrites ou annulées.
Malgré les prix élevés du pétrole en 2024, le déficit courant devrait se réduire grâce à la hausse des exportations en lien avec l’ouverture de la mine de lithium de Goulamina, la production de coton, la vente d’animaux vivants et les cours élevés de l’or, qui représente 80% des revenus d’exportations. Le déficit des services se maintiendra, obéré par la logistique, essentiellement le fret, et les services de défense (Wagner), alors que les recettes touristiques ne devraient pas augmenter en raison du climat d’insécurité. Les rapatriements des bénéfices miniers par les compagnies étrangères diminueront légèrement grâce à l’appropriation d’une plus grande part des dividendes par l’Etat. L’excédent des revenus secondaires restera soutenu par les transferts de fonds des expatriés, mais les aides officielles seront freinées par la dégradation des liens avec les pays occidentaux. Les emprunts extérieurs resteront limités, tout comme les IDE non-miniers, le déficit sera donc essentiellement financé par les investissements en direction du secteur extractif.
La transition civile est incertaine, alors que le climat sécuritaire reste préoccupant
Arrivée au pouvoir après deux coups d’Etat, en 2020 et 2021, la junte militaire est dirigée par le colonel Assimi Goïta, président intérimaire du Mali. La transition civile qu’elle s’est engagée à mener, sous la pression des sanctions initiales de la CEDEAO, est compromise par le report sine die des élections législatives et présidentielle, initialement prévues en octobre 2023 et février 2024, respectivement. L’approbation à 97% d’une nouvelle constitution, en juin 2023, a conforté la junte, assurant l’amnistie aux auteurs des coups d’Etat et permettant à certains membres de se présenter à la présidentielle. Toutefois, la participation au référendum était faible (38%) et le vote entravé dans certaines localités du nord et du centre. Par ailleurs, le gouvernement est fragilisé par l’insécurité persistante. Dans le Nord, la junte est confrontée à une double menace : d’une part, l’enracinement des groupes djihadistes affiliés à Al Qaida et à l’Etat Islamique, et d’autre part, la résurgence des combats avec les indépendantistes Touaregs en septembre 2023. En 2024, le Mali devra contenir l’insécurité sans l’aide occidentale, puisque, à la demande des autorités locales, les troupes françaises se sont retirées en octobre 2022, et celles de l’ONU (MINUSMA), en décembre 2023. La milice d’obédience russe Wagner continuera d’y participer, alors que les relations militaires et économiques étroites avec la Russie se maintiendront, les deux pays ayant signé, en novembre 2023, un accord pour la construction d’une raffinerie locale d’or à Bamako. Avec le report des élections, le Mali restera suspendu des instances de la CEDEAO avec laquelle il entretiendra des relations toujours tendues, d’autant que le pays a conclu un pacte de défense mutuelle avec les régimes militaires du Niger et du Burkina Faso en septembre 2023. L’Alliance des Etats du Sahel (AES) a pour vocation la lutte contre les groupes terroristes, mais aussi le rapprochement économique et militaire, puisque les trois pays se sont engagés à une assistance mutuelle en cas d’attaque extérieure.
Dernière mise à jour : Décembre 2023